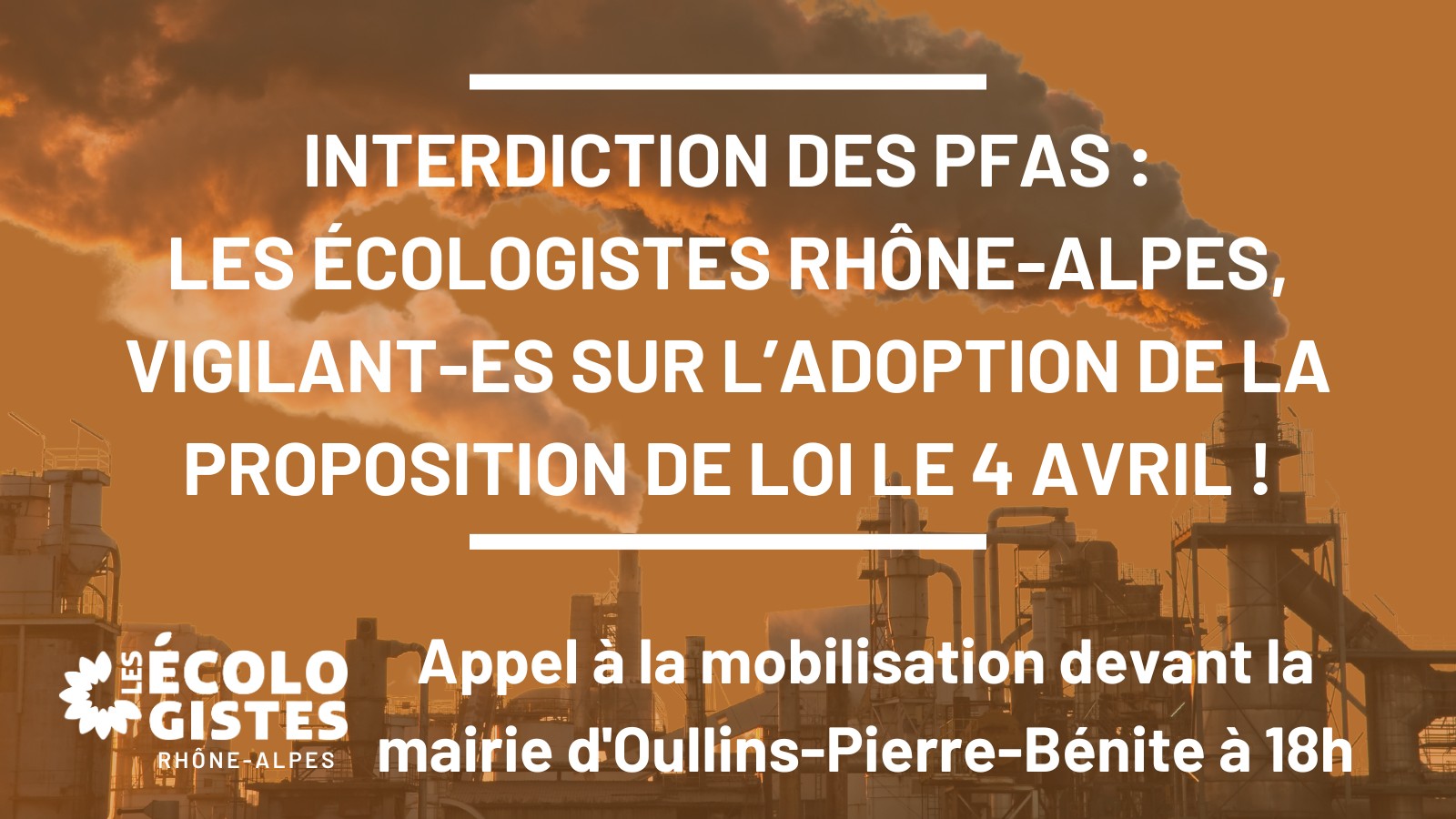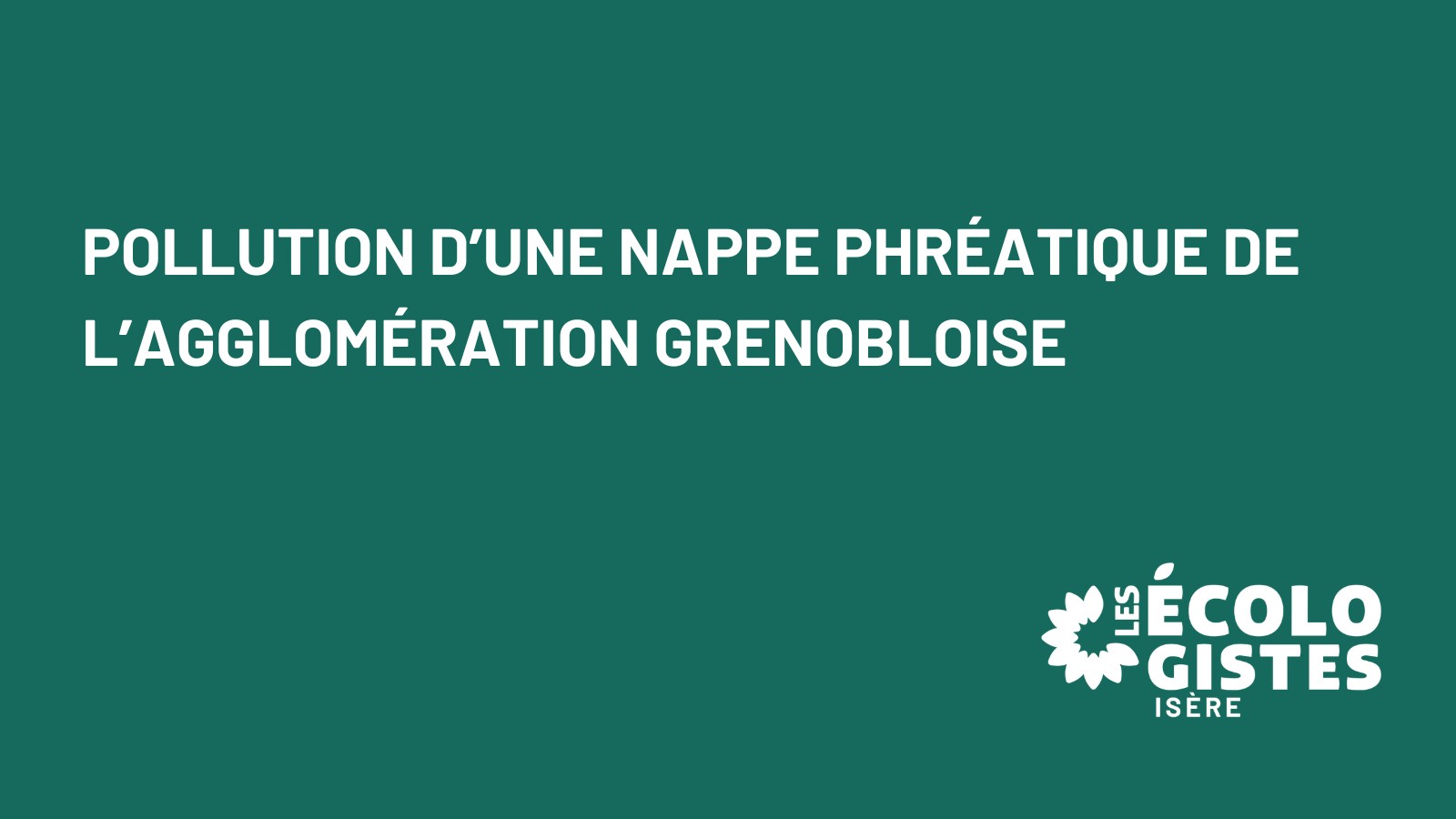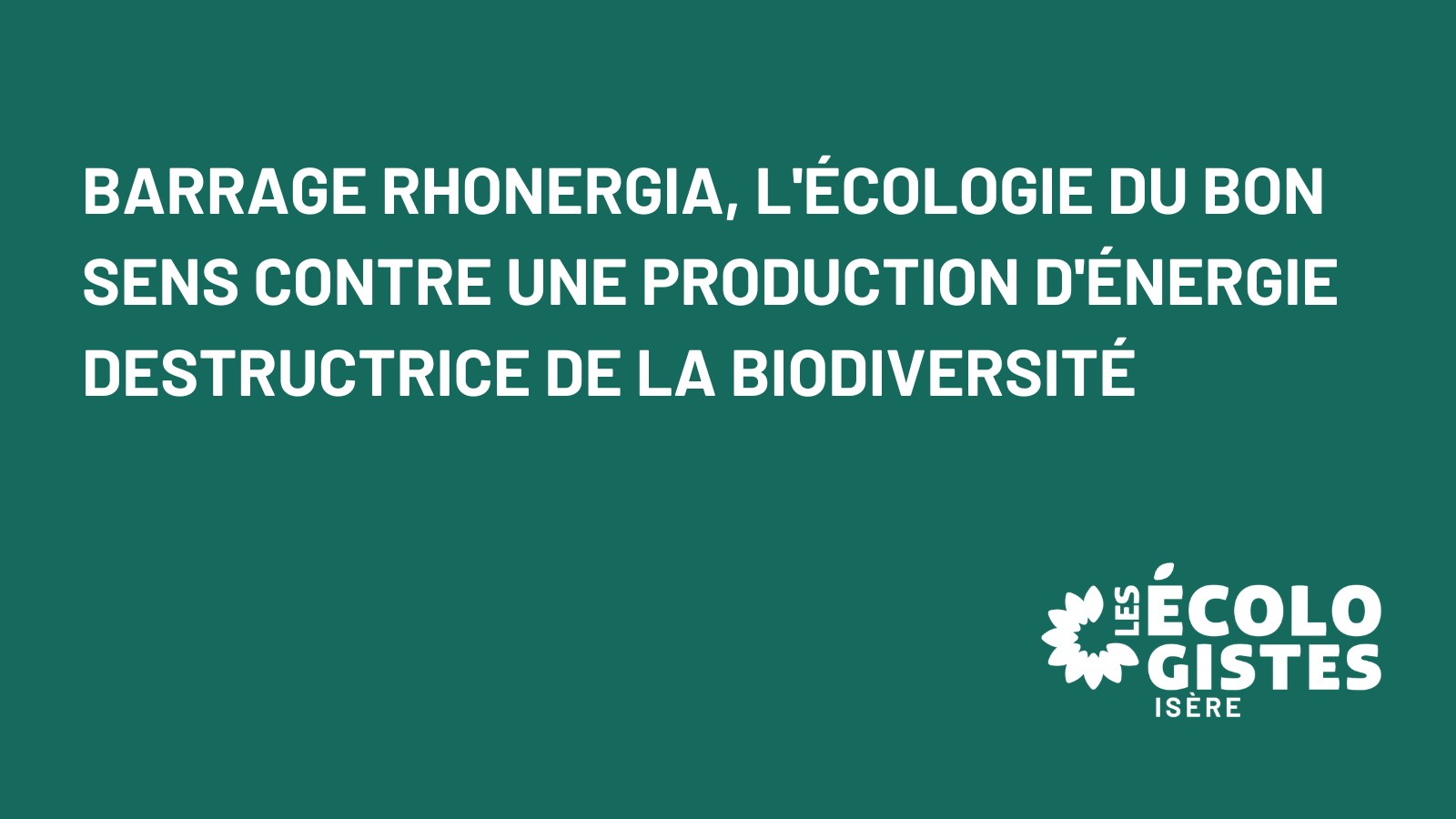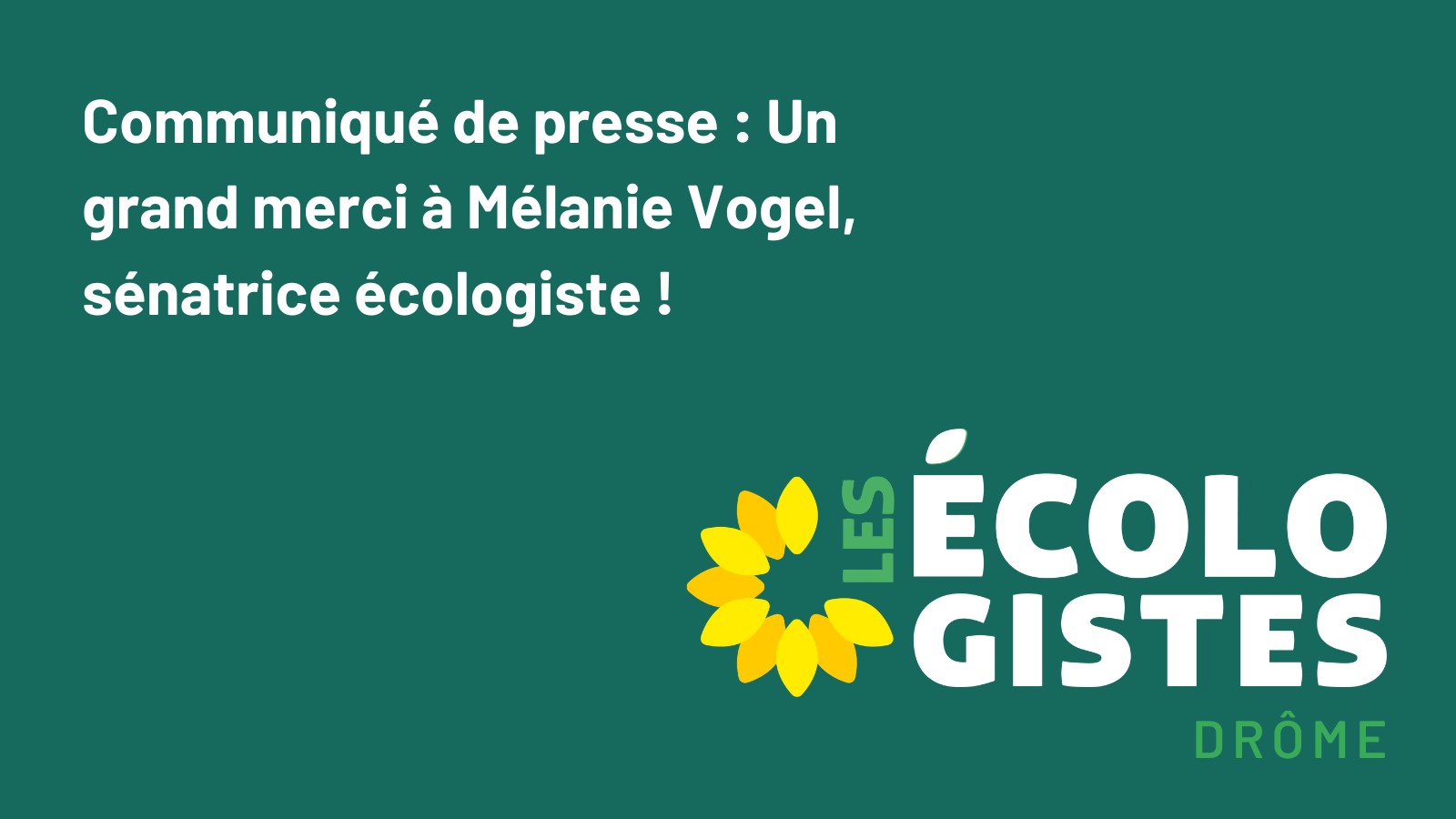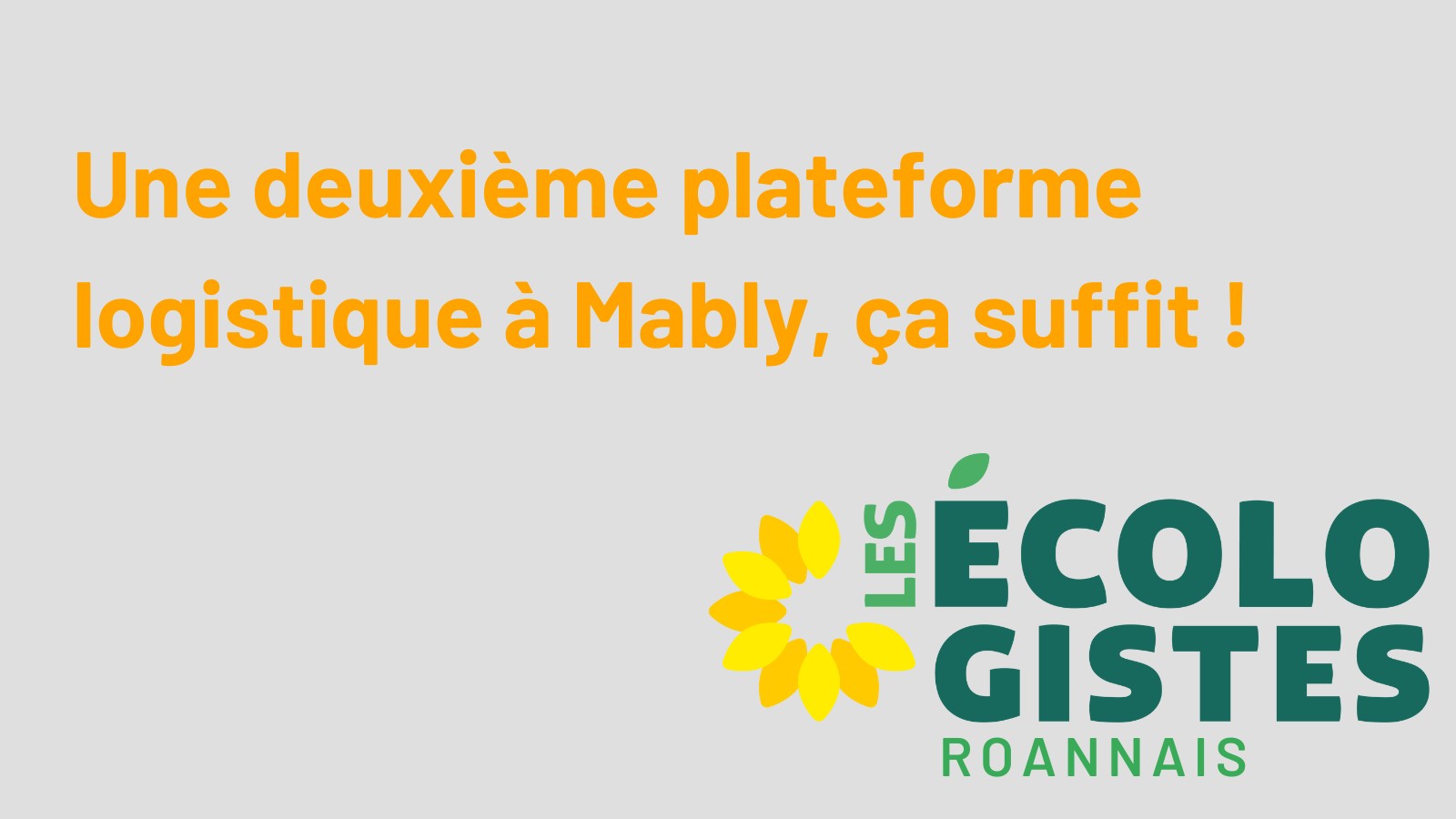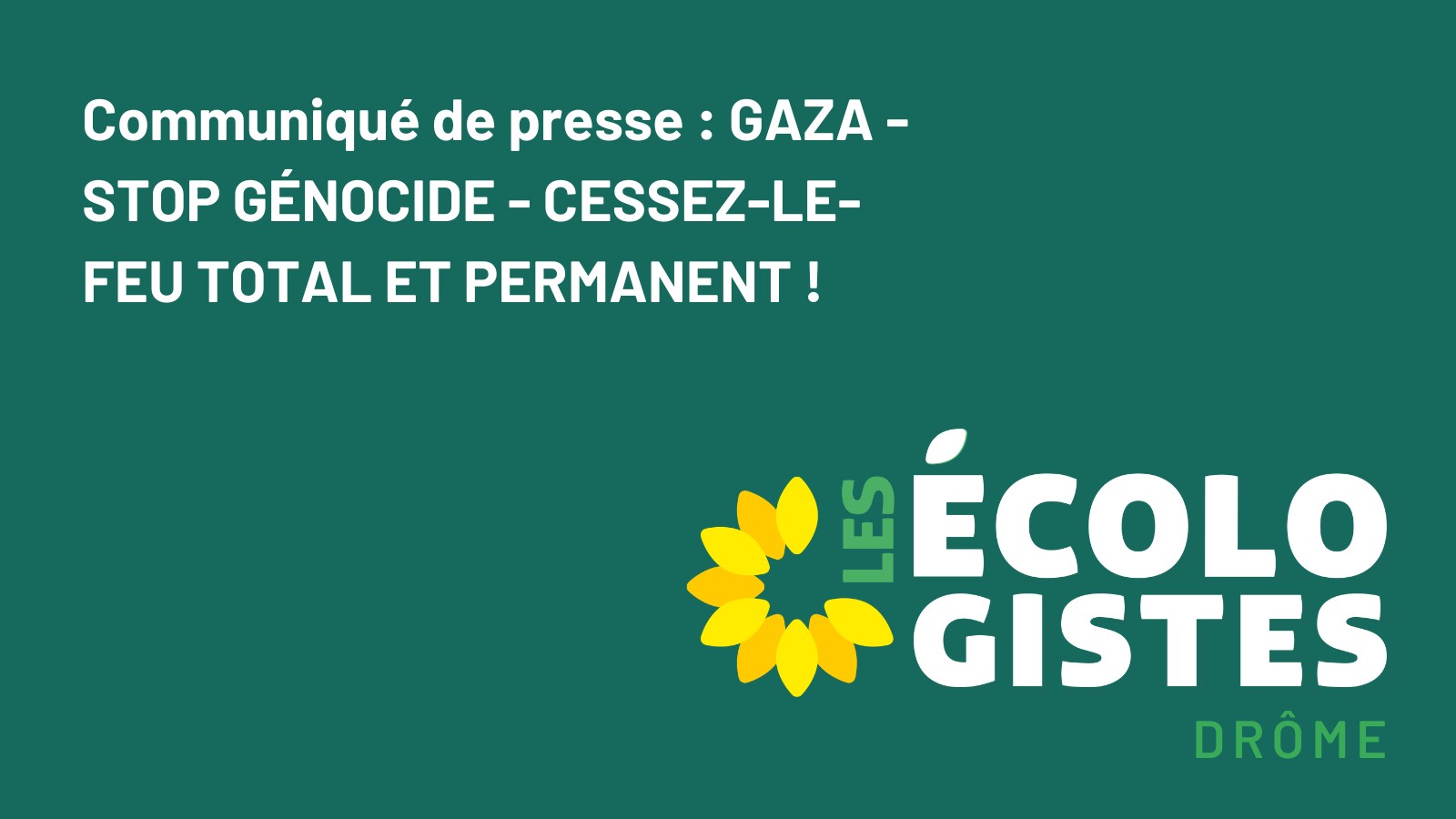Le député écologiste Nicolas Thierry a déposé une proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (appelées aussi "polluants éternels" ou PFAS).
Lors de son passage en commission développement durable le 27 mars, les députés de la majorité présidentielle (Renaissance, Démocrates, Horizons), Les Républicains et du Rassemblement national ont essayé de réduire l'ambition de ce texte.
Cette proposition de loi doit désormais être discutée en séance publique le 4 avril 2024 dans le cadre de la niche parlementaire des Ecologistes. Rien n'est gagné et la mobilisation doit continuer !
La persistance, les effets toxicologiques et la prolifération de ces polluants sont 3 raisons suffisantes pour justifier des actions immédiates, en particulier des interdictions à la source des émissions, une surveillance accrue des milieux naturels, des denrées alimentaires et de l’eau potable, et des mesures de dépollution dans les hotspots.
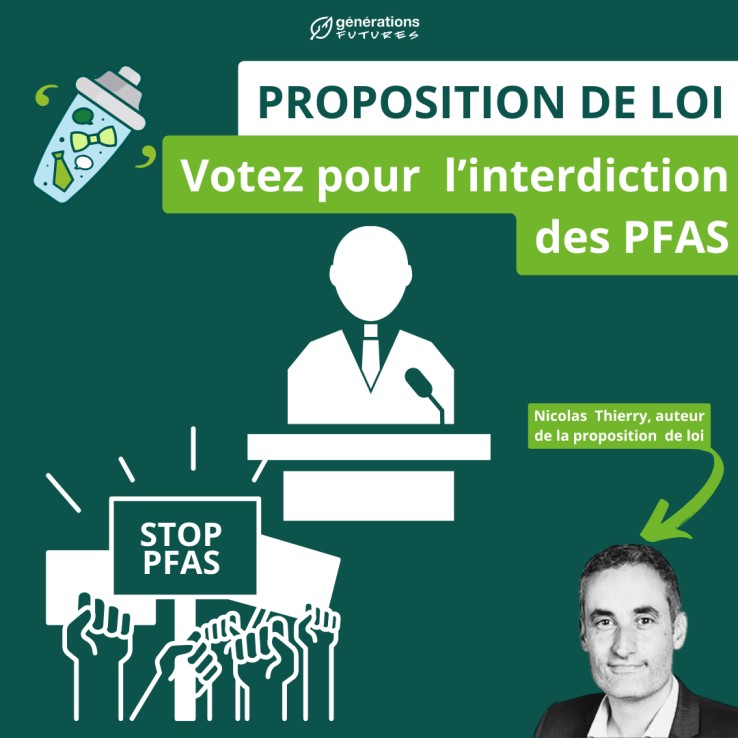
Actualités
Rejoignez Les Écologistes près de chez vous
Engagez-vous pour l'écologie
PLATEFORME D’ACTION